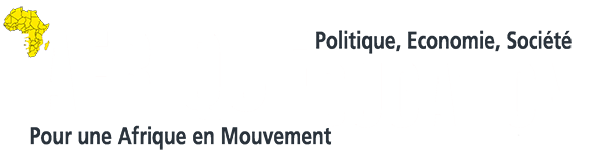X
AES – UEMOA : Quand Ouattara refuse la présidence en exercice de l’UEMOA à Ibrahim Traoré (parce que pro-russe et anti-français)

Date
Le 11 juillet dernier, à Lomé, une scène inédite s’est jouée à la réunion de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les représentants des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) — le Burkina Faso, le Mali et le Niger — ont quitté les lieux prématurément. A l’origine de cet incident, le refus opposé par plusieurs chefs d’Etat, dont Alassane Ouattara, à la présidence tournante du Conseil des ministres de l’UEMOA, qui devait cette année revenir au Burkina Faso.
L’UEMOA, censée incarner une intégration économique solidaire et équitable entre ses membres, traverse une crise de légitimité. En refusant au Burkina Faso le droit de présider, cette année, le Conseil des ministres, l’organisation s’expose à des critiques de partialité et de duplicité politique. Pourtant, le principe de rotation est l’un des fondements de la gouvernance de cette institution. En empêchant Ouagadougou de prendre la tête de cette instance, on viole une règle non écrite mais respectée jusqu’ici : chaque pays, quelle que soit sa situation politique, doit avoir sa place à la table des décisions.

Les dirigeants de l’AES n’ont pas tardé à réagir. Ils ont considéré ce refus comme une injustice, voire, une insulte, à l’endroit du Burkina Faso. Leur départ anticipé de la réunion est un message fort, mais aussi, un aveu : l’UEMOA ne parvient plus à incarner l’unité et la neutralité qu’elle revendique. Elle devient, au contraire, le théâtre d’un affrontement idéologique et diplomatique entre Etats « légitimés » et Etats « mis au ban », dans une Afrique de l’Ouest de plus en plus polarisée.
Le précédent ivoirien : une mémoire sélective ?
La position d’Alassane Ouattara, fer de lance du rejet de la présidence burkinabè, interroge. En 1999, lorsque Henri Konan Bédié fut renversé par un coup d’état en Côte d’Ivoire, le pays ne fut pas pour autant exclu des instances sous-régionales. Mieux encore, la Côte d’Ivoire conserva la présidence de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ouattara, qui fut premier ministre avant de devenir président, semble, aujourd’hui, oublier cette période où les règles de solidarité régionale avaient prévalu sur les clivages politiques.
Cette mémoire sélective nourrit l’idée selon laquelle certains pays sont traités avec indulgence, tandis que d’autres sont systématiquement sanctionnés. La position de la Côte d’Ivoire s’apparente, ainsi, à une politique à géométrie variable, fondée non sur des principes, mais, sur des intérêts et des affinités politiques. Pourquoi accepter certains régimes issus de putschs et pas d’autres ?
Des coups d’état « acceptables » ?
La question mérite d’être posée. Si Alassane Ouattara affirme s’opposer à tout coup de force, pourquoi alors a-t-il reçu avec tous les honneurs, à Abidjan, le général, Brice Oligui Nguema, arrivé au pouvoir par un coup d’état au Gabon le 11 avril 2024 ? Deux ans plus tôt, le 5 septembre 2022, Alassane Ouattara échangeait avec le lieutenant-colonel, Paul-Henri Damiba, qui effectuait une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire. Damiba et Nguema avaient-ils été élus démocratiquement ? Absolument pas. Ils avaient pris le pouvoir par la force, exactement, comme l’ont fait les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger.
La rencontre entre les deux militaires et Ouattara est révélatrice d’un double standard. Certains coups d’état sont apparemment plus « fréquentables » que d’autres, en fonction des alliances géopolitiques, des enjeux économiques, ou encore, des appartenances idéologiques. On finit par se demander s’il existe de « bons » et de « mauvais » putschistes.

Ce deux poids deux mesures, décrédibilise l’ensemble des discours sur la démocratie et l’état de droit. A force de faire des distinctions arbitraires, les institutions africaines se vident de leur sens et perdent la confiance des peuples. La cohérence n’est plus au rendez-vous, et c’est tout le projet d’intégration régionale qui en pâtit.
Une légitimité à géométrie variable
Le comble de cette situation est qu’on oublie souvent que bien des dirigeants qui se posent en champions de la démocratie sont eux-mêmes arrivés ou restés au pouvoir dans des conditions controversées. Briguer un troisième ou un quatrième mandat, modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, écarter arbitrairement des opposants de la course électorale, manipuler les résultats… (le cas s’applique à Alassane Ouattara). Ces pratiques, pourtant légion en Afrique de l’Ouest, ne sont pas moins graves que les coups d’état militaires qu’on (Ouattara) s’empresse de condamner. Pour qui se prend-il ?
Le respect de la légalité ne peut être à sens unique. On ne peut condamner les transitions militaires tout en fermant les yeux sur les abus du pouvoir civil. Cette hypocrisie alimente le ressentiment populaire et justifie, dans l’esprit de certains citoyens, le recours à des formes de rupture brutale.
Repenser la solidarité régionale
Il est temps pour les organisations régionales africaines de faire leur propre examen de conscience. L’UEMOA, la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et autres structures d’intégration ne peuvent continuer à fonctionner selon des logiques d’alliances politiques fluctuantes. La solidarité ne doit pas être une faveur accordée à certains et refusée à d’autres. Elle doit être un principe universel, appliqué avec rigueur et impartialité.

Si c’est au tour du Burkina Faso de présider le Conseil des ministres de l’UEMOA, alors ce droit doit lui être reconnu. Il ne s’agit pas, ici, de soutenir tel ou tel régime, mais, de défendre un principe, une équité. La présidence tournante ne peut devenir un outil de sanction politique déguisé.
En fin de compte, ce que réclament les pays de l’AES, ce n’est pas un traitement de faveur, mais, un traitement équitable. Leur retrait de la réunion du 11 juillet 2025 est un signal fort, mais aussi, un appel à la cohérence. L’heure n’est plus aux exclusions sélectives ni aux indignations à géométrie variable.
Si l’Afrique de l’Ouest veut bâtir une intégration solide et durable, elle doit le faire sur la base de règles claires, appliquées à tous sans distinction. Le respect mutuel, la justice et la cohérence doivent primer sur les calculs politiques. Un point un trait.
Jean-Claude DJEREKE
Est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).