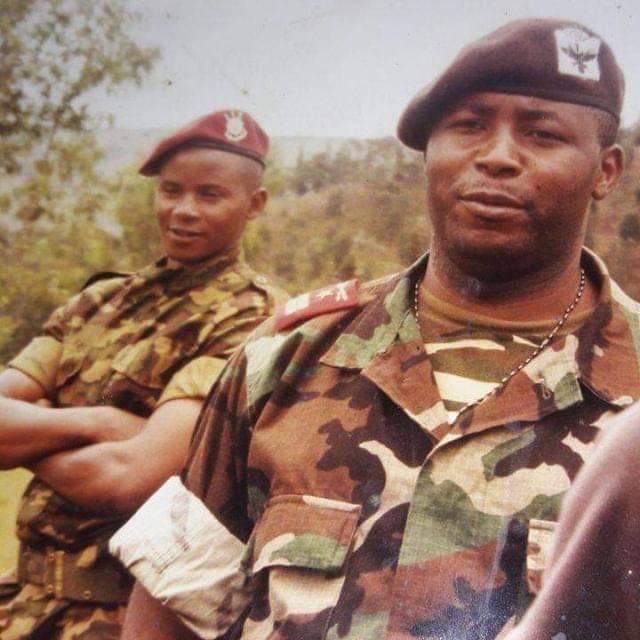X
COTE D’IVOIRE : Quand la colère tue la sagesse

Date
« Lorsque la colère surgit, pensez
aux conséquences. » – Confucius
Nous avons tous appris que le PDCI-RDA et le PPA-CI, deux partis qui ont toujours tenu à participer à toutes les élections et qui s’étaient constitués en « Front commun », ont décidé d’adopter des postures différentes pour les élections législatives de décembre 2025. Les soutiens de ce « Front commun » qui avaient suivi les mots d’ordre de cette coalition contre le 4è mandat de M. Ouattara et qui comptaient sur l’union qui fait la force, seraient désemparés face à cette divergence d’approche. L’éclatement du « Front commun » à l’approche des élections législatives est-il un choix rationnel ou un choix pragmatique ? Sera-t-il payant pour le PDCI-RDA ou pour le PPA-CI, à court ou à long terme ?
Qualificatif de ce qui s’appuie sur la « raison », le « rationnel » se définit comme ce qui est fondé sur une approche logique. L’intuition liée à ce concept est celle d’un principe de pertinence et de bon choix à validité interpersonnelle. Est rationnel ce qui qualifie une pensée, une action ou une connaissance s’appuyant sur la logique, l’ordre et la méthode. Le rationnel se distingue du pragmatique en ce que ce dernier est adapté à l’action concrète qui privilégie les résultats d’une action et l’expérience qui en découle comme critères de vérité et de sens des idées. Comprendre une idée, c’est comprendre comment elle pourrait être appliquée et comprendre les implications de la mise en œuvre de cette idée. Les Américains, Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey, ont défini le pragmatisme comme une proposition ou une action qui dépend de ses effets pratiques ou, comme diraient leurs détracteurs, qui « n’est vrai que si elle marche ».
Le pragmatisme en politique serait donc une attitude fondée sur le réalisme, une approche qui privilégie l’observation des faits et l’adaptation à la réalité, une forme d’empirisme qui valorise non seulement l’action, mais l’efficacité dans la mise en pratique de ce qui fonctionne réellement, plutôt que des considérations abstraites ou théoriques. Car toute idée, toute théorie, toute proposition politique ne peut être considérée comme vraie, et donc comme valable, que quand elle peut agir sur le réel.
L’éclatement du « Front commun » s’explique-t-il seulement par la tradition sacro-sainte qui veut qu’un parti attaché à la démocratie participe à toutes les joutes électorales, fussent-elles profondément viciées, ou se fonde-t-il sur la grande colère et le ressentiment face à un régime sourd à tout dialogue et à tous les appels du pied ? Se justifie-t-il au regard du respect strict de la discipline interne au parti ?
En effet, quelques jours après le dépôt des candidatures aux élections législatives, on ne peut s’empêcher d’observer une grande agitation et des luttes intestines dans tous les états-majors, parti au pouvoir et opposition confondus, avec des candidatures rejetées ou contestées et des candidatures indépendantes ; en d’autres termes, un branle-bas qui indique une précipitation dans les préparatifs du processus de dépôt des candidatures aux élections législatives et, sans nul doute, dans la campagne électorale qui va suivre.

Il ne s’agit même plus d’une bataille rangée. Tout le monde est en colère contre tout le monde., en interne comme en externe. On n’est pas loin de la bataille prophétisée d’Harmagédon. Nulle conscience du rationnel et du pragmatique, nulle conscience de la logique, de l’ordre et de la méthode, nulle conscience de l’objectif final, et nulle conscience de ce qui « n’est vrai que si ça marche ». La colère, le ressentiment et cette rancœur profonde, moteur de la « morale d’esclave » et du désir de puissance et de revanche incapable d’action positive viennent encore une fois de prendre le dessus et de tuer la sagesse (voir Nietzsche). On ne se bat pas, ou du moins, on ne se bat plus pour le peuple, et on ne se met plus au service du peuple. On ne réfléchit plus, on refuse de réfléchir et on s’éloigne de la réalité.
Et dire que nous sommes embourbés dans cette « gadoue » depuis bientôt 30 ans et devrions savoir que la colère, un des sept péchés capitaux, ne conduit qu’à des résultats désastreux et tragiques. Quand donc saurons-nous qu’une fois que la colère s’empare de notre esprit, elle en chasse rapidement la logique, la raison, la compassion, la miséricorde et toutes les formes de sagesse. Si la colère parle vite, la sagesse prend le temps de réfléchir et elle seule peut tuer la colère et sauver cette Nation, la seule que nous ayons.
Paulin G. Djité, PhD, NAATI III, AIIC
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques