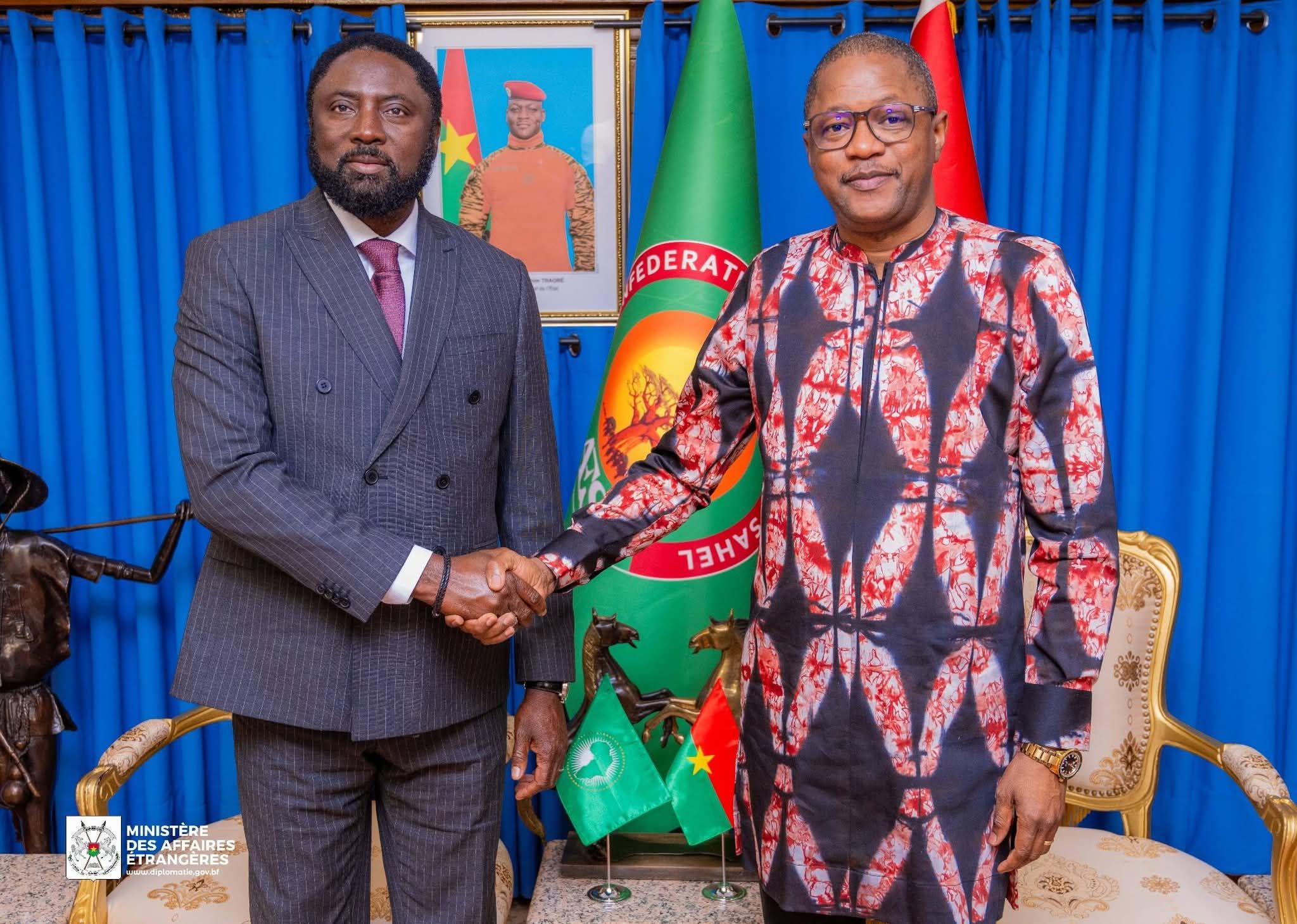X
EDUCATION A L’EMPATHIE : Montée du narcissisme juvénile et enjeux de formation des enseignants

Date
Cet article examine la progression du narcissisme chez les jeunes dans les sociétés contemporaines, phénomène largement documenté par les sciences sociales et les travaux en psychologie du développement. Il analyse les facteurs familiaux qui contribuent à l’émergence précoce de comportements égocentrés, puis, mobilise l’exemple du Klassens tid danois comme modèle d’éducation socio-émotionnelle. S’appuyant notamment sur les recherches de la psychologue, Michele Borba, l’article interroge la pertinence d’une pédagogie institutionnalisée de l’empathie. Enfin, il insiste sur une dimension largement sous-estimée dans les débats publics : La nécessité d’une formation initiale et continue robuste des enseignants pour garantir l’efficacité et la sécurité de telles pratiques.
Ces dernières décennies ont vu s’accentuer un ensemble de comportements relevant d’une forme de narcissisme juvénile, souvent, associé à une focalisation accrue sur l’image de soi, la reconnaissance sociale immédiate et la compétition statutaire. Ce phénomène, perceptible dans de nombreux contextes scolaires, alimente des préoccupations éducatives majeures : Tensions entre pairs, fragilisation du climat scolaire, multiplication des micro-agressions et baisse des compétences socio-émotionnelles.
Cette contribution vise à analyser de manière critique cette évolution, à en identifier certains déterminants familiaux et scolaires et à explorer le rôle que pourrait jouer l’éducation à l’empathie dans la construction de dynamiques relationnelles plus équilibrées. Une attention particulière sera portée à la question de la formation des enseignants, trop souvent, négligée alors qu’elle constitue un déterminant central de la réussite de ces dispositifs.
Narcissisme juvénile : Etat des lieux et enjeux
Le narcissisme est appréhendé dans la littérature comme une orientation durable vers la valorisation excessive du soi, souvent, corrélée à une hypersensibilité au regard d’autrui. Chez les jeunes, plusieurs études pointent une augmentation de ces traits au cours des dernières décennies. Cette évolution est liée à divers facteurs structurels : Développement massif des réseaux sociaux, transformations des modèles parentaux, importance accrue accordée à la performance individuelle.
Sur le terrain scolaire, cette hausse se manifeste par des comportements de supériorité, de comparaison sociale permanente et, parfois, de mépris envers des camarades perçus comme moins conformes aux normes valorisées. Elle génère des tensions, accroît les risques de harcèlement et crée des environnements peu propices au développement socio-affectif.
Facteurs familiaux et transmission des attitudes égocentriques
Les dynamiques intrafamiliales participent de manière significative à l’installation précoce d’attitudes narcissiques. Les modèles de communication centrés sur la réussite individuelle, l’usage d’un langage implicitement hiérarchisant ou le renforcement permanent du “statut” de l’enfant, produisent des effets d’imitation particulièrement marqués.
Ainsi, les enfants internalisent des représentations sociales souvent hiérarchisées, qu’ils réinvestissent ensuite dans leurs interactions scolaires. Plusieurs recherches en psychologie du développement montrent que les attitudes parentales, même subtiles, structurent fortement les scénarios relationnels des enfants.
L’exemple du Danemark : Le Klassens tid comme dispositif socio-émotionnel
Dans la perspective d’une réponse éducative à ces phénomènes, l’exemple du Danemark occupe une place centrale. Le Klassens tid, moment hebdomadaire institutionnalisé dans les écoles primaires et secondaires, vise à soutenir le développement des compétences émotionnelles, à réguler les conflits et à promouvoir des interactions sociales plus égalitaires. Bien que souvent présenté comme un “cours d’empathie”, ce dispositif relève plutôt d’une approche intégrée d’éducation socio-émotionnelle. Il repose sur la verbalisation des émotions, la résolution collaborative des tensions et l’apprentissage de l’écoute active. Les études disponibles indiquent qu’il contribue à améliorer le climat scolaire et à réduire certaines formes de violence interpersonnelle.
Apports des recherches de Michele Borba
Les travaux de Michele Borba constituent une référence dans l’analyse du déficit empathique contemporain. L’auteure souligne une baisse notable des compétences empathiques chez les jeunes et une progression concomitante des traits narcissiques. Elle met également en évidence les liens entre ce déficit empathique et différents risques psychosociaux : Isolement, troubles anxieux, difficultés relationnelles.
Pour Borba, une éducation structurée de l’empathie constitue un levier majeur pour restaurer les dynamiques prosociales. Toutefois, elle rappelle que cette compétence ne peut se développer de manière spontanée : elle doit être enseignée, pratiquée et valorisée au sein des institutions éducatives.
La nécessité d’une formation approfondie des enseignants
Si le modèle danois suscite l’intérêt, sa transposition dans d’autres contextes ne peut être envisagée sans une réflexion approfondie sur la formation des enseignants. Les compétences requises — gestion des émotions, médiation, régulation des interactions, connaissance des processus de socialisation — relèvent d’un champ spécialisé.

Or, sans formation adéquate, les enseignants peuvent se retrouver en difficulté : Imprécision des objectifs, gestion problématique des conflits, exposition non maîtrisée des élèves vulnérables. L’efficacité, mais aussi, la sécurité psychologique des élèves, dépend alors directement du niveau de préparation professionnelle.
Plusieurs travaux démontrent que la formation des enseignants constitue un facteur déterminant de la réussite des programmes socio-émotionnels. Elle doit donc être pensée
comme une composante essentielle et non accessoire de toute politique d’éducation à l’empathie.
Conclusion
La progression du narcissisme juvénile constitue un enjeu éducatif majeur, dont les répercussions dépassent largement le cadre scolaire pour toucher les dynamiques sociales dans leur ensemble. L’éducation à l’empathie apparaît comme une réponse prometteuse, à condition de s’appuyer sur des dispositifs structurés, scientifiquement, fondés et intégrés au fonctionnement des établissements.
L’exemple du Danemark offre des éléments inspirants, mais, sa transposition exige des ajustements contextuels et, surtout, une politique ambitieuse de formation des enseignants. Sans cette condition, les programmes d’empathie risquent de se réduire à des initiatives symboliques, dépourvues d’effets réels sur les comportements.
Promouvoir une éducation socio-émotionnelle rigoureuse, portée par des professionnels formés, pourrait cependant constituer l’un des leviers les plus puissants pour répondre à la montée de l’individualisme et reconstruire des relations sociales fondées sur la coopération et le respect mutuel.
Dr. Lahcen Benchama