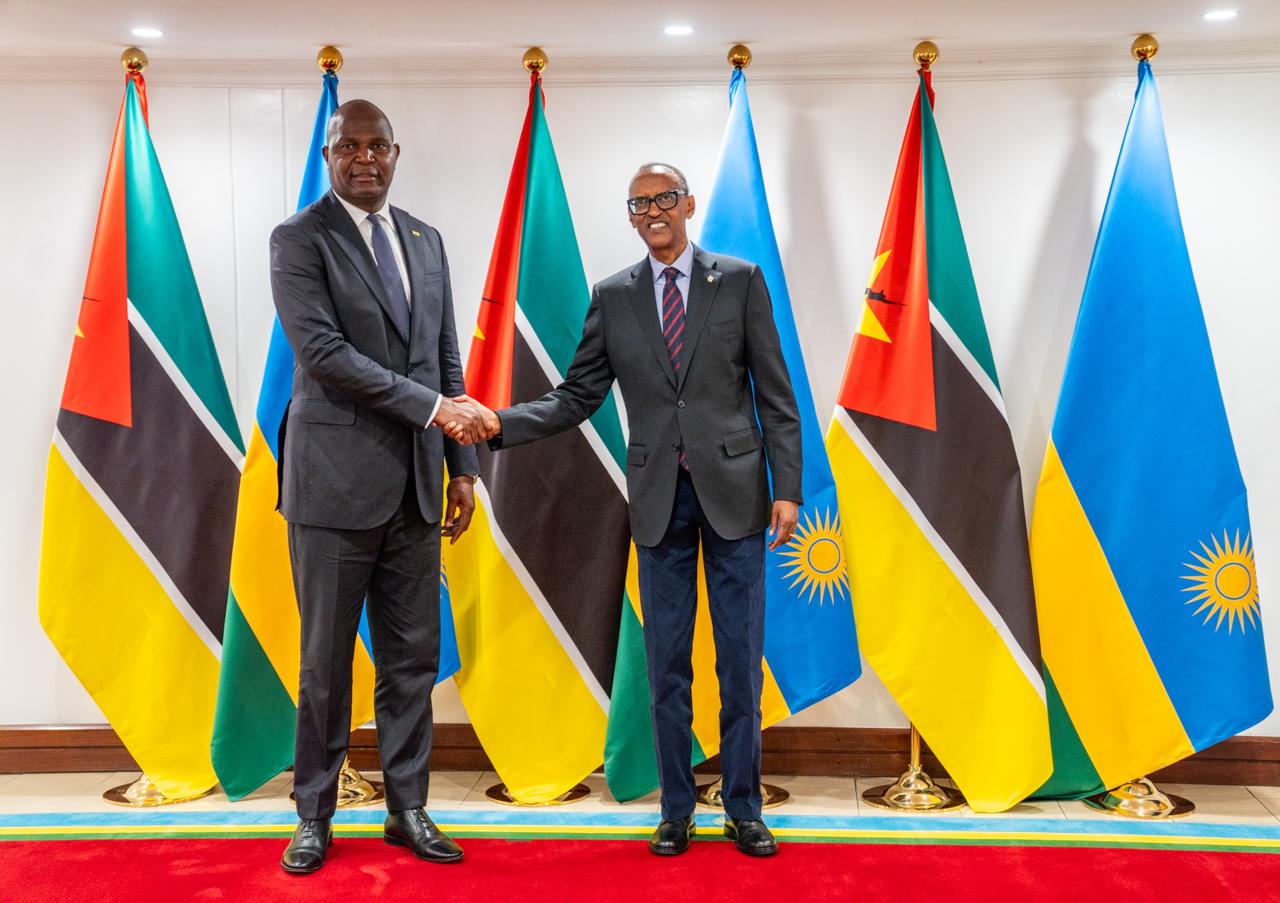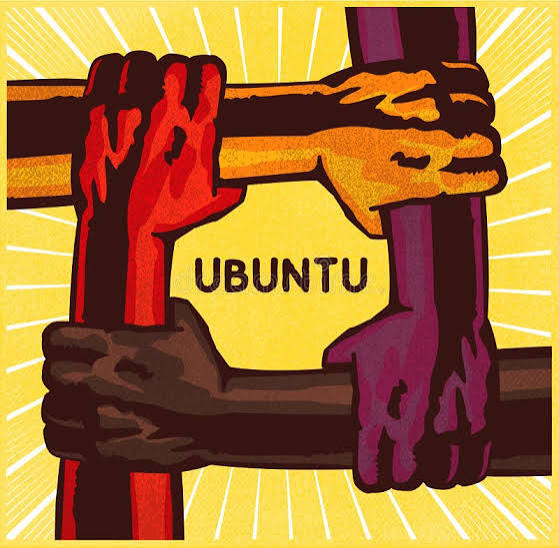X
COTE D’IVOIRE : Quand l’hospitalité devient un piège mortel

Date
« C’est notre hospitalité qui nous a tués », a reconnu avec amertume le chef central de Nahio, village ivoirien devenu le théâtre d’un drame atroce le 25 octobre. Ce jour-là, des habitants, connus pour leur accueil et leur sens du partage, ont été brûlés vifs ou abattus par ceux-là mêmes qu’ils avaient hébergés, nourris et intégrés dans leur communauté. Ces « étrangers », selon les mots du chef, étaient armés de lance-roquettes, de RPG et de fusils AK. Une scène de guerre dans un village paisible. Une tragédie qui interroge le sens de la fraternité, de la citoyenneté et de la confiance.
Une hospitalité trahie
Dans les traditions africaines, accueillir l’étranger est un devoir sacré. L’hôte est considéré comme un envoyé de Dieu, un visiteur que l’on doit protéger et honorer. Mais, à Nahio, cette valeur ancestrale a été pervertie. Ceux que les villageois ont reçus avec bonté ont transformé cette hospitalité en faiblesse, cette ouverture en brèche fatale.
Le chef central, les yeux pleins de douleur, résume la tragédie en une phrase lourde de sens : « C’est notre hospitalité qui nous a tués ». Derrière ces mots, se cache un cri de désespoir, mais aussi, une accusation implicite : Qui a armé ces hommes ? Qui leur a fourni les RPG, les AK-47, les munitions ? Quoi qu’il en soit, la population de Nahio se sent trahie par un système où l’étranger semble parfois avoir plus de droits que le citoyen (sur notre photo, une maison en feu comme une vingtaine d’autres qui ont subi le même sort).
Quand l’étranger devient instrument politique
La question du statut de l’étranger est depuis longtemps un sujet sensible en Côte d’Ivoire. Depuis les années 1990, les débats autour de la nationalité, de la citoyenneté et du droit de participation politique ont souvent servi de levier de division.
Accueillir l’étranger n’a rien de condamnable en soi. Mais, lorsque cet étranger devient un instrument politique, un moyen de domination ou de manipulation, alors l’équilibre communautaire se fissure. Le drame de Nahio montre jusqu’où peuvent mener ces dérives. Quand on préfère l’étranger à ses propres frères, quand on lui accorde des privilèges auxquels il n’a pas droit, quand on s’allie à lui pour faire du tort à son propre peuple, c’est l’existence même de la nation qui vacille. Le sang versé à Nahio est celui d’une double trahison : Trahison de la fraternité humaine et trahison de la patrie.

La fracture de la confiance
Aujourd’hui, Nahio n’est plus seulement un village meurtri. C’est un symbole de la fragilité du vivre-ensemble. Comment, après une telle trahison, continuer à tendre la main ? Comment reconstruire la confiance entre communautés ? Les survivants racontent encore, la voix tremblante, comment ils partageaient leurs repas avec ceux qui allaient, quelques jours plus tard, sortir les armes contre eux. L’hospitalité, valeur sacrée, a été souillée par la violence. Et la peur s’installe désormais dans les cœurs : Peur de l’autre, même du voisin.
Ce drame doit nous amener à repenser les notions de solidarité et de fraternité. Accueillir ne veut pas dire se soumettre. Aider ne signifie pas s’aveugler. Il faut savoir distinguer la main tendue de la main qui prépare un coup. Quand on préfère l’étranger à ses propres frères, quand on se met avec lui pour faire du tort à son frère, on met en danger l’existence même du pays.
Leçons d’un drame
La Côte d’Ivoire a toujours été une terre d’accueil, mais elle ne peut rester terre d’innocence face à la manipulation et à la violence. Le drame de Nahio doit devenir le point de départ d’une prise de conscience collective. Il ne s’agit pas de rejeter l’étranger, mais de réapprendre à protéger la communauté, à poser des limites, à exiger la réciprocité et le respect.
Un pays qui ne sait plus défendre ses frontières morales, sociales et politiques s’expose à toutes les infiltrations — pas seulement militaires, mais aussi idéologiques.
Il faut enquêter pour savoir d’où viennent ces armes de guerre, qui les a introduites dans le pays, qui a financé ou toléré ces réseaux. Il faut également encadrer plus rigoureusement les politiques d’installation, de naturalisation et de participation politique.

Mais, surtout, il faut redonner confiance aux autochtones comme aux résidents étrangers honnêtes, pour que l’hospitalité retrouve son sens premier : celui du partage dans la paix.
Vers une conscience nationale renouvelée
Nahio pleure ses morts, mais son cri ne doit pas se perdre dans le vent.
Ce drame, aussi cruel soit-il, peut être le point de départ d’un sursaut national. Un moment où chaque citoyen, chaque responsable politique, chaque chef communautaire se demande : Que faisons-nous de notre pays ? Sommes-nous encore capables de défendre nos valeurs sans haine mais avec lucidité ?
L’hospitalité est une vertu, mais elle ne peut survivre sans justice. La fraternité est une force, mais elle se brise si la loyauté disparaît. Ce que Nahio nous enseigne, c’est qu’un peuple qui oublie de se protéger finit par s’effacer. Alors, oui, le drame de Nahio doit être le début d’une prise de conscience, non pas, contre l’étranger, mais pour la souveraineté morale et politique du pays.
Jean-Claude Djéréké
est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)