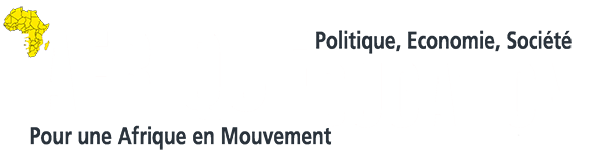X
Accueil>Arts et Lettres>LITTERATURE : “La carte d’identité” de Jean-Marie Adiaffi a 40 ans cette année
LITTERATURE : “La carte d’identité” de Jean-Marie Adiaffi a 40 ans cette année

Date
“ L’intellectuel n’est rien s’il ne vit pas entièrement dévoué à la cause de son peuple, s’il n’est pas une part de ce peuple, rien qu’une part, une part embrasée, mais une part tout de même, une part intégrée puisqu’au centre, mais une part sans privilège, sans honneur particulier. C’est cela être un intellectuel pour un peuple soumis, humilié, bafoué, exploité, asservi : se fondre au sein de son peuple au risque de s’y perdre.”
C’est précisément pour servir la cause de son peuple – les Agni de Bettié en Côte d’Ivoire et les Africains en général – qu’Adiaffi, l’auteur de cette citation, décide d’écrire « La carte d’identité ». Le héros de ce roman, Mélédouman, ne comprend pas que lui, que tout le monde connaît dans son village parce qu’il est facilement reconnaissable par ses scarifications, soit sommé par Kakatika, le commandant blanc, de trouver en une semaine sa carte d’identité, après avoir été arrêté et humilié devant les siens (sa famille et son peuple) et après avoir été torturé en prison. Mais le prince agni, qui a perdu la vue suite aux mauvais traitements subis en prison, aura besoin d’un guide pour se lancer dans cette aventure. C’est sa petite fille, Ebah Ya (7 ans), qui jouera ce rôle. C’est avec elle qu’il ira à la recherche de sa carte d’identité. Le génie d’Adiaffi a consisté à transformer la quête d’un papier en une quête identitaire en utilisant le calendrier traditionnel akan.
Avant de commencer le voyage de sept jours, Mélédouman va demander à ses ancêtres de “soutenir ses pas chancelants sur cette route jonchée d’invisibles embuscades” (p. 60). Au cours de ce voyage, le héros découvre les symboles, les arts et les croyances religieuses, bref tout ce qui fait l’originalité et la force de la civilisation agni.
À travers le voyage de Mélédouman, c’est l’Afrique en perte de repères qui est invitée à revisiter et à valoriser sa culture. Pour Adiaffi, les langues africaines, qui sont un élément important de cette culture, méritent la même considération que celles du Blanc parce qu’elles sont « le support et le véhicule de la culture, du maintien des valeurs ancestrales et de la mémoire collective ». Adiaffi rejoint ici Fanon pour qui seul « un complexe d’infériorité peut expliquer la mise en tombeau de l’originalité culturelle locale et la valorisation de la langue du colonisateur ». Sans prôner un repli sur soi, Jean-Marie Adiaffi met les Africains en garde contre une détestation de leurs langues car, “si nous enterrons nos langues, dans le même cercueil, nous enfouissons à jamais nos valeurs culturelles, toutes nos valeurs culturelles d’autant plus profondément que n’ayant pas d’écriture, la langue reste l’unique archive” (p. 107). Il rappelle à chaque Africain la nécessité de se retourner pour regarder d’où il vient quand il ne sait plus où il va. Lorsque Mélédouman déclare à l’instituteur Ablé qu’aujourd’hui “nous n’avons plus rien, nous ne sommes plus rien”, c’est Adiaffi qui parle aux Africains et s’insurge contre l’assimilation qui contribue à la perte de leur identité.
Mais, en parlant aux Africains, l’auteur s’adresse aussi aux Occidentaux imbus d’eux-mêmes, se croyant supérieurs à ceux qui sont différents d’eux et convaincus comme le commandant Kakatika que le Noir n’a ni culture ni civilisation et qu’il doit adopter celles du Blanc. Kakatika osera même affirmer que les Noirs sont « de grands enfants paresseux, fainéants, stupides et n’ayant aucune qualité morale ni intellectuelle tandis que le Blanc est la perfection de la vertu, l’essence secrète qui dévoile toute chose ». Avant Kakatika, Hegel, Gobineau et d’autres penseurs occidentaux de la deuxième moitié du 19e siècle avaient intoxiqué et trompé leurs compatriotes avec ce genre de clichés et de sornettes.
Le père Joseph ne se distingue pas de Kakatika puisqu’il profane l’île sacrée, “pille statuettes, tambours parleurs et masques sacrés pour orner son salon” (p. 86).
A la fin du voyage de sept jours, Mélédouman annonce au commandant de cercle qu’il n’a pas trouvé sa carte d’identité. Non seulement Kakatika ne le fait pas arrêter mais il le vouvoie. C’est ensuite au tour des gardes de se mettre au garde-à-vous pour le saluer. Bref, le commandant reconnaît enfin l’identité de Mélédouman en lui rendant les honneurs. Mieux encore, il lui présente les excuses de l’administration pour « cet incident regrettable » (p. 151).
Autant le commandant Kakatika s’excuse d’avoir humilié le prince agni à la fin du roman, autant la France politique refuse toujours de reconnaître et de regretter les massacres et exactions qu’elle commit en Afrique pendant la colonisation. Au lieu de demander pardon pour les nombreux crimes perpétrés dans cette partie du continent depuis 1960, année où elle fit semblant de partir, elle s’obstine à parler du “rôle positif de la présence française outre-mer” (article 4 de la loi du 23 février 2005). Or, selon Alain Gresh, même si “des routes et des chemins de fer ont été construits, ce n’était pas d’abord dans l’intérêt des colonisés mais pour permettre l’exploitation des richesses au profit de la métropole”. Le journaliste français ajoute : “Aucun historien ne prétendra que le nazisme a joué un « rôle positif » parce qu’il a bâti un important réseau d’autoroutes. L’entreprise coloniale est condamnable car elle est fondée sur l’idée de l’inégalité des êtres humains, sur l’existence de « races inférieures » et le droit des « races supérieures » à les civiliser.” (A. Gresh, ‘Idée reçue : la colonisation a aussi eu des effets positifs’ dans “Le Monde diplomatique”, septembre 2014). En attendant le jour où les autorités françaises feront leur mea culpa, peut-on en vouloir aux anciens colonisés d’Afrique de penser avec Adiaffi que “le monde n’est qu’un vaste mensonge, un bouquet de douleurs, un complot contre la vie, un funeste complot contre la liberté et la justice”?
Publié en 1980 par Hatier, le roman “La carte d’identité” reçoit le Grand prix littéraire d’Afrique noire l’année suivante. Ici, comme dans “Galerie infernale”, “D’éclairs et de foudres” ou “Silence, on développe”, les mots de l’écrivain ressemblent à des “coups de pilon dans la gueule des oppresseurs”.
Cinéaste et enseignant de philosophie, Adiaffi (notre photo) décède le 15 novembre 1999 à l’âge de 58 ans.
Jean-Claude DJEREKE
est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).