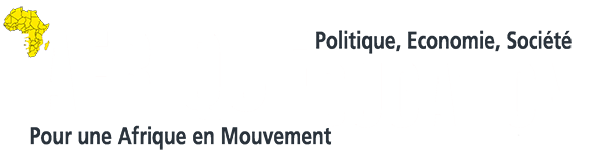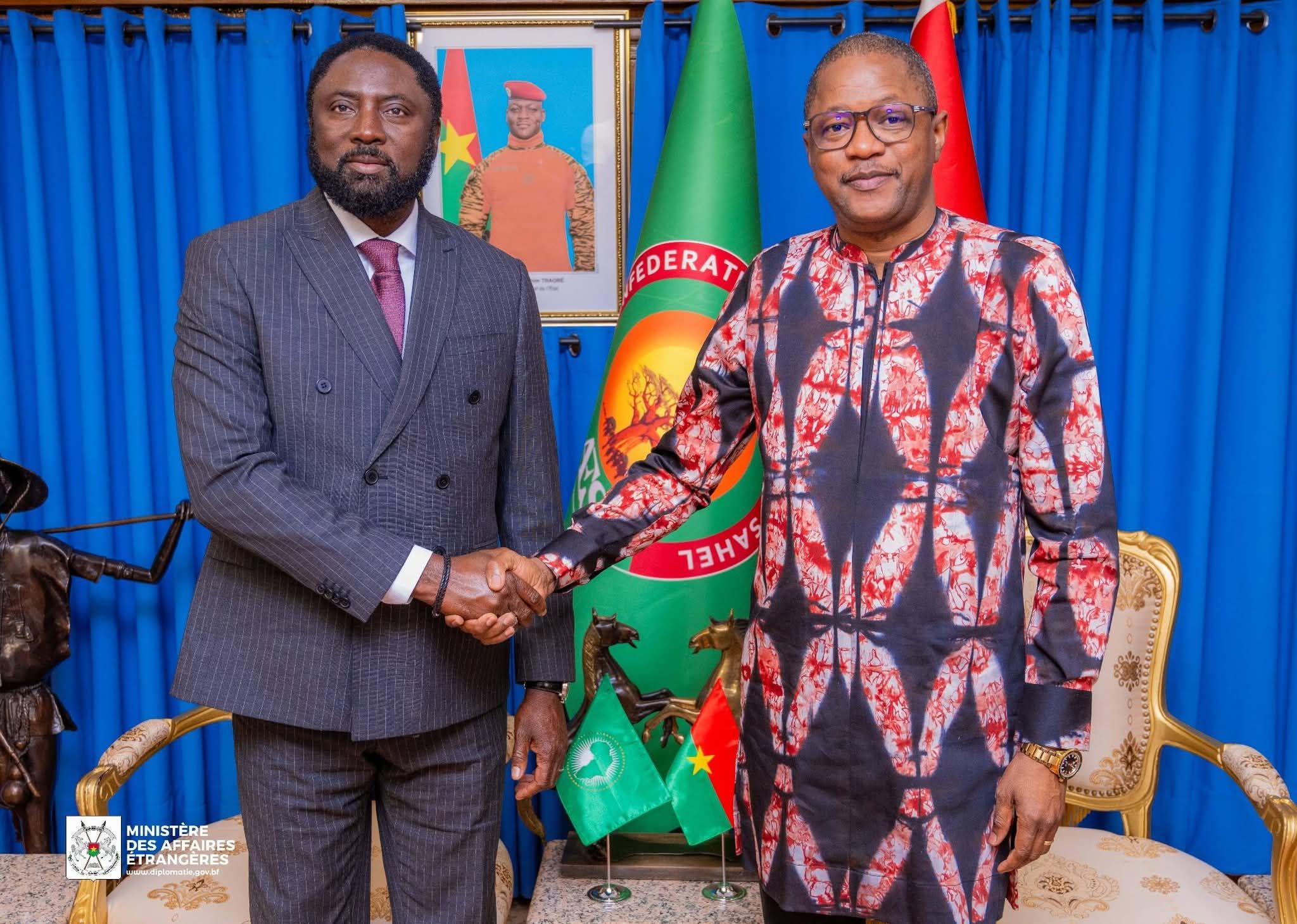X
Accueil>Idées neuves>FRANCE : Analyse juridique du refus opposé par le Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales
FRANCE : Analyse juridique du refus opposé par le Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales

Date
Article destiné à être publié dans une revue en sciences politiques, juridiques et économiques :
Temps de lecture : 22 minutes
AVERTISSEMENT : La célèbre revue Afrique Éducation, ainsi que l’Université Paris-Nanterre n’entendent donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans cet article. Ces opinions doivent être considérées comme étant propres à son auteur, dans le respect, et, conformément aux principes de neutralité et de réserve qui s’imposent à l’ensemble des agents de la fonction publique française. Cet article juridique entre dans le cadre des études universitaires de Marc Aurélien TEDGA, notamment, en ce qui concerne la préparation de son mémoire de recherche en droit public. C’est à cœur joie que nous partageons son article à l’ensemble de nos lecteurs.
Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (cf. article 61-1 de la Constitution), un justiciable a, d’ores et déjà, la possibilité, lors d’une instance en cours devant une juridiction administrative ou judiciaire, d’invoquer qu’une disposition législative promulguée par le président de la République, après son adoption au Parlement, porterait excessivement atteinte aux droits et libertés que la Constitution du 4 octobre 1958 doit garantir. Le même principe constitutionnel s’applique également à la phrase introductive du Préambule (alinéa 1er) de la Constitution du 27 octobre 1946 (cf. décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994), ou de son 16e alinéa (cf. décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018) – ou encore – concernant les 17 articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789, qui ont aussi valeur constitutionnelle (cf. décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). De plus, il est également très important de noter que les 10 articles de la Charte de l’environnement de 2004 ont aussi valeur constitutionnelle (cf. décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008) ; (cf. décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014). Ainsi, ces mécanismes constitutionnels offrent au justiciable la possibilité de faire valoir qu’une disposition législative serait contraire à la Constitution à travers une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La QPC permet de favoriser l’intégration du justiciable dans le contrôle de constitutionnalité des lois adoptées au Parlement. Cette question de constitutionnalité peut être posée devant toutes les juridictions inférieures relevant, par exemple, du Conseil d’État (juridiction suprême de l’ordre administratif), ou alors, de la Cour de cassation (juridiction suprême de l’ordre judiciaire) (cf. article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
Historiquement, lorsque les pères de la Constitution du 4 octobre 1958 (dont le Général de Gaulle et Michel Debré) ont rédigé la loi fondamentale (Constitution), ces derniers n’avaient pas prévu que le Conseil constitutionnel se transformerait, quelques années plus tard, en une véritable Cour constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel avait initialement été créé en vue de doter notre ordre juridique d’une Grande Instance pouvant assurer un contrôle rigoureux du respect de la délimitation entre le domaine de la loi et celle du règlement. Cette ambition politique n’avait pas pour vocation d’établir un gouvernement des juges car le Conseil constitutionnel devait plutôt apparaître comme un contre-pouvoir juridictionnel et non comme une juridiction politique (pour faire allusion à la Cour de Justice de la République). De plus, il est important de savoir que le Conseil d’État et la Cour de cassation sont, par ailleurs, des juges du filtre dans la procédure des QPC puisqu’il leur appartient, en toute souveraineté, d’apprécier la recevabilité de la QPC et, le cas échéant, d’en décider la transmission aux Sages du Conseil constitutionnel.
Aujourd’hui, la décision de transmettre ou de refuser la transmission d’une QPC par les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peut parfois être incomprise ou mal interprétée par le justiciable et, dans certains cas, insuffisamment motivée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Pour illustrer mon propos, nous nous concentrerons ici sur la QPC portant sur la répartition des compétences du préfet de Police de Paris en matière de police de la circulation, tout en faisant le parallèle avec les compétences de la maire de Paris.Ainsi, nous nous interrogerons à savoirpourquoi le Conseil d’État a-t-il refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ?
Dans cet article juridique, nous apporterons certes, des éléments de langage, mais nous essayerons également d’apporter des solutions juridiquement applicables face aux multiples enjeux que peut soulever ce sujet. Pour traiter cette question, nous analyserons dans une première grande partie les motivations du Conseil d’État de ne pas transmettre cette QPC (I), puis, nous verrons dans une seconde grande partie que cette décision est très probablement entachée d’incertitude, et qu’il aurait (peut-être) été judicieux, voire légitime, de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel (II).

I – Conseil d’État : Une décision « juridiquement motivée »
Conformément à l’article L. 2512-14 du CGCT (Loi n° 2017-257 du 28 février 2017, article 25 et 30, en vigueur le 1er juillet 2017), la maire de Paris (en ce qui concerne la circulation) « exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article ». Ainsi, c’est le préfet de Police de Paris « qui règlemente de façon permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des Institutions de la République et des représentations diplomatiques », (modifié par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, article 38-II et III, en vigueur le 1er janvier 2019). Par exemple, lors des Jeux Olympique et Paralympique de Paris 2024, c’est le préfet de Police de Paris, qui, en application de cette disposition législative, réglemente de façon permanente les conditions de circulation et de stationnement au sein de la capitale, compte tenu des enjeux liés à cet événement sportif de très grande envergure, mais également, pour assurer la sécurité d’éminentes personnalités publiques présentes sur le territoire parisien. Autre exemple, cette fois-ci plus illustratif : ce sont toujours les fonctionnaires de la préfecture de Police qui assurent la sécurité de la Présidence de la République Française (Palais de l’Élysée). La maire de Paris ne dispose d’aucune prérogative législative pour réglementer les conditions de circulation et de stationnement aux alentours de la première Institution de la République et des autres Institutions suprêmes de l’État.
En faisant un tel constat, certains justiciables de la collectivité parisienne, s’estimant eux-mêmes lésés par l’article L. 2512-14 du CGCT, ont pris l’initiative de déposer des mémoires auprès du greffe du tribunal administratif (TA) de Paris. Cela aura été le cas, par exemple, pour M. B… A… demandant l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2012 du préfet de Police de Paris portant réservation d’emplacements pour le stationnement des véhicules du ministre du Travail. En effet, dans ses conclusions, M. B… A… soutenait que les deux premiers alinéas de l’article L. 2512-14 du CGCT « méconnaissent l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le principe d’égalité et portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales » (cf. article 1 de la DDHC) ; (cf. article 1 de la Constitution) ; (cf. article 72 de la Constitution) ; (cf. article L. 1111-1 du CGCT / loi n° 82-213 du 2 mars 1982, article 1, alinéa 1). Par la demande de M. B… A…, le greffe du TA de Paris, a décidé de transmettre le mémoire du requérant contenant une QPC au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, pour décider s’il avait lieu ou pas de transmettre ladite QPC aux Sages du Conseil constitutionnel.
Quelques semaines plus tard, après avoir examiné la demande du requérant, le Conseil d’État a décidé en toute souveraineté de ne pas transmettre la QPC soulevée par M. B… A… au Conseil constitutionnel (cf. Conseil d’État, 10 octobre 2013, n° 370154). Ce refus « juridiquement motivé » s’explique pour plusieurs raisons. D’abord, la Haute juridiction administrative estime que la QPC de M. B… A… ne présente pas un caractère sérieux, ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que la QPC du justiciable ne révélait pas un problème constitutionnel réel. En effet, les juges du filtre invoquent fréquemment, face à la partie plaignante, l’absence de caractère sérieux justifiant la transmission d’une QPC. Dans notre cas, le Conseil d’État estime en toute légitimité, que : « le législateur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 72 de la Constitution », étant donné que les collectivités territoriales de la République, « s’administrent librement » et « dans les conditions prévues par la loi » (cf. loi n° 2003-276 du 23 mars 2003, article 5). Ici, l’article L. 2512-14 du CGCT est une disposition législative qui résulte directement de la volonté du législateur de conférer à la maire de Paris des pouvoirs de police plus limités que ceux du préfet de Police, qui, pour sa part, conserve une position prééminente dans ce domaine. Par conséquent, en dépit des débats juridiques, le Conseil d’État a pu fonder sa décision de manière pleinement légale.
Par ailleurs, l’absence de caractère sérieux n’est pas uniquement justifiée par la jurisprudence susmentionnée. En effet, le Conseil d’État considère également qu’il n’y a aucune rupture d’égalité entre la collectivité parisienne et les autres collectivités municipales françaises. La Haute juridiction soutient que : « la situation particulière, au regard de la sécurité des personnes et des biens et du maintien de l’ordre public, de la capitale et de certains secteurs de son territoire, notamment en raison de la présence du siège des Institutions de la République et des représentations diplomatiques, ne peuvent être regardées comme introduisant, entre la Ville de Paris et les autres communes ou entre les habitants de la capitale, des différences de traitement contraires à la Constitution ». L’approche du juge administratif qui pourrait éventuellement susciter la controverse, ne reste pas moins justifiée d’un point de vue juridique (pour ne pas parler politique), car il est notable de savoir, d’une part, que la Ville de Paris est la commune historique de l’État centralisateur, et d’autre part, que la Ville de Paris, est un territoire incontestablement spécifique, car elle contient sur son territoire l’ensemble des Institutions suprêmes de la République (Présidence de la République, Conseil constitutionnel, ministères, Sénat, Assemblée nationale, Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes, Conseil économique social et environnemental…), sans compter l’ensemble des ambassades et consulats siégeant au sein de la capitale, avec ces nombreux monuments historiques et ces prestigieux établissements d’enseignement supérieur. Par conséquent, la QPC déposée par M. B… A… soutenant que les dispositions législatives de l’article L. 2512-14 du CGCT ne répondent pas « à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de loi », ne présente pas un caractère sérieux pour la Haute juridiction administrative. Pour le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de renvoyer cette QPC aux Sages du Conseil constitutionnel.
ATTENTION : Contrairement aux idées reçues, la maire de Paris dispose bien de compétences en matière de circulation, conformément à l’article L. 2213-1 du CGCT (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 50), lequel précise toutefois qu’elles s’exercent sous réserve des pouvoirs attribués au représentant de l’État dans le département et sur les routes à grande circulation. Ainsi, même si la réduction de la vitesse sur le boulevard périphérique, de 70 km/h à 50 km/h, a été initiée par la maire de Paris, la décision juridique définitive relève du préfet de Police dont l’accord était indispensable (pour faire le parallèle avec l’article L. 2512-14 du CGCT).
À présent, il s’agira d’étudier, dans cette seconde grande partie, que même si la décision de la Haute juridiction administrative est « juridiquement motivée », elle n’en demeure pas moins marquée par une certaine incertitude et reste sujette à débat au sein de l’opinion publique.

II – Conseil d’État : Une décision « potentiellement entachée d’incertitude et sujette à débat »
Si la différence de traitement entre la collectivité parisienne et les autres collectivités municipales françaises ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité contraire à la Constitution, le statut juridique de la Ville de Paris n’en demeure pas moins vivement débattu parmi les Parisiens. À plusieurs reprises, l’exécutif parisien a dénoncé certaines prérogatives législatives qu’il estime injustes en matière de pouvoirs de police. D’ailleurs en 2015, la maire de Paris avait même rédigé une note à l’attention du Premier ministre de l’époque, Manuel VALLS, pour lui faire savoir qu’il était nécessaire de davantage partager les compétences en matière de police entre le préfet de Police et la maire de Paris. De plus, plusieurs sénateurs ont également déposé à la Présidence du Sénat une proposition de loi pour modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police (cf. M. Yves POZZO di BORGO, P. CHARON et P. DOMINATI, proposition de loi tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police, Sénat, publié le 1er avril 2015). Ces initiatives multiples conduiront quelques années plus tard, à la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 susmentionnée relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Cependant, cette nouvelle loi n’accorde aucun pouvoir de police supplémentaire à la maire de Paris, notamment en matière de circulation et d’ordre public. Cette retenue illustre une fois encore, la difficulté persistante de l’État à transférer des compétences jugées « sensibles » à l’exécutif parisien, malgré le fait que le gouvernement de l’époque ait la même couleur politique que les dirigeants parisiens (parti socialiste).
D’ailleurs, lors de la soutenance de fin d’études de Marc Aurélien TEDGA, Monsieur Jean-Hugues BARBÉ (Maître de conférences en droit public et Co-directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris-Saclay), estimait également qu’il est tout à fait normal, au vu de la situation sensible de la Ville de Paris, que « ce soit une préfecture de Police qui en assure la sécurité, compte tenu des enjeux de sécurité particulièrement importants ». De plus, M. Joseph ASPIRO SEDKY (expert en droit public, enseignant à l’Université Paris-Saclay, consultant en droit des collectivités territoriales et formateur ENM, CRFPA, IEJ et Dalloz), soutenait également cette thèse comme quoi « une situation particulière exige des conditions particulières », ce qui justifie totalement une différence de traitement entre la Ville de Paris et les autres communes françaises (cf. Conseil d’État, 18 avril 1902, n° 04749) ; (cf. Conseil d’État, 10 mai 1974, n° 88032). Par conséquent, il n’y pas de débat juridique possible sur la question.
Néanmoins, pour reprendre l’intitulé de cette seconde grande partie, la décision de la Haute juridiction administrative peut effectivement être considérée comme « potentiellement entachée d’incertitude et sujette à débat », et ce, d’abord parce que, malgré les justifications précédemment évoquées par le Conseil d’État, il n’empêche que la Ville de Paris n’en demeure pas moins une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution, car elle dispose d’une assemblée délibérante (Conseil de Paris), et exerce l’ensemble de ses prérogatives sous le contrôle du représentant de l’État, de l’opposition municipale et, plus largement, de ses administrés.
Ensuite, les notions mobilisées par le Conseil d’État pour valider la dérogation au droit commun apparaissent particulièrement larges et indéterminées, laissant ainsi au législateur comme aux autorités administratives une marge d’interprétation considérable. La référence à des « secteurs particulièrement sensibles », par exemple, soulève de nombreuses interrogations. Qu’entend-on précisément par-là ? À l’heure de la menace terroriste persistante, ne peut-on pas considérer que les abords des écoles sont des lieux sensibles ? Face à la montée de l’islamophobie et de l’antisémitisme, les mosquées et synagogues ne constituent-elles pas également des espaces particulièrement exposés ? Les gares des communes de la banlieue parisienne, fortement fréquentées et parfois vulnérables, ne pourraient-elles pas, elles aussi, entrer dans cette catégorie ? Où peut-être qu’il est plus important de protéger les ministres et les hauts-fonctionnaire de la République par rapport aux citoyens ?
Autrement dit, Paris n’est certainement pas le seul territoire sensible de la République. La singularité qui justifie l’exception parisienne n’apparaît donc pas pleinement convaincante, d’autant plus que l’État s’inscrit aujourd’hui dans une logique de délocalisation de certaines institutions nationales. Dès lors, la frontière posée par le Conseil d’État semble moins nette qu’il n’y paraît, ce qui alimente l’incertitude et le débat autour de la portée réelle de sa décision. Pour justifier mon propos, nous pourrions prendre pour exemple, l’idée innovante en 2018 du Premier ministre, Édouard Philippe, de « délocaliser temporairement » les services de Matignon pendant plusieurs jours dans la Haute-Garonne, le Cher et le Lot.
En imaginant un instant que l’idée innovante du Premier ministre ait été mise en œuvre, il aurait fallu s’interroger sur les conséquences législatives d’une telle réforme. Le législateur aurait-il alors accepté de modifier la loi au profit des représentants de l’État et au détriment des élus locaux pour ces trois départements de province ? Si la réponse est positive, il aurait été difficile de justifier qu’une telle évolution législative ne s’applique pas également à d’autres territoires où sont implantées des administrations souveraines de l’État. On peut citer, par exemple, le service du casier judiciaire national ou le service central d’état civil des Français nés à l’étranger, tous deux délocalisés à Nantes. Ces administrations, qui assurent des missions hautement sensibles, pourraient-elles aussi, par analogie, justifier une intervention renforcée de l’État dans les compétences locales en matière de police de la circulation ou d’ordre public. Une telle dynamique ferait cependant peser un risque majeur : celui de transformer la notion de « déconcentration et de décentralisation » en un simple subterfuge juridique permettant, en réalité, une reprise en main centralisatrice des territoires par l’État, sous prétexte que certaines administrations souveraines de la République se trouveraient implantées dans des territoires sur lesquels l’État n’exerce que très peu de contrôle. On assisterait alors à un recul manifeste du modèle décentralisé patiemment construit depuis la fin du XXe siècle (acte I des lois de la décentralisation, sous la présidence de François Mitterrand).
Pour revenir à la décision du Conseil d’État, il apparaît que les critères retenus, « secteurs particulièrement sensibles » ; « impératifs de sécurité » et « spécificité parisienne », ne sont ni exhaustifs ni définis avec une grande précision. Leur portée demeure incertaine et leur interprétation largement ouverte. C’est pourquoi il aurait été opportun que le Conseil d’État saisisse le Conseil constitutionnel sur la question de la constitutionnalité de l’article L. 2512-14 du CGCT, car je pense que sa décision aurait pu poser un cadre jurisprudentiel clair, notamment dans la perspective, où les institutions nationales situées à Paris pourraient un jour être délocalisées dans d’autres collectivités territoriales situées en province. Quoi qu’il en soit, une chose semble certaine : la question de la répartition territoriale des Institutions de la République réapparaîtra tôt ou tard dans le débat politique et juridique, et les incertitudes relevées par la jurisprudence du 10 octobre 2013 ne pourront alors qu’être réexaminées de façon plus attentive.
NB : Toute ressemblance entre l’analyse juridique ici développée et l’idée d’un « gouvernement des juges » ne saurait être que pure coïncidence. À mon sens, la notion de « gouvernement des juges » n’est qu’une grossière illusion simplificatrice, parfois instrumentalisée par certains courants politiques, et qui contribue, hélas, à affaiblir la légitimité du pouvoir judiciaire dans notre État de droit. Il convient de rappeler que le juge français se borne à appliquer la loi, expression de la volonté générale, telle qu’adoptée par le Parlement, représentant de la souveraineté nationale. La même philosophie juridique s’applique au juge constitutionnel dont la mission consiste uniquement à vérifier la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution. Il convient de rappeler que la Constitution du 4 octobre 1958 a été adoptée par voie référendaire, et constitue, à ce titre, l’expression directe de la souveraineté nationale. Dès lors, le juge — qu’il soit ordinaire ou constitutionnel — ne fait qu’appliquer le droit et la justice « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » (cf. article L.111-1 du Code de l’organisation judiciaire). Les responsables politiques, lorsqu’ils décident de s’exprimer sur ces questions, devraient faire preuve de grande rigueur qu’exige le droit, à défaut, il leur appartient de ne surtout pas travestir les principes fondamentaux de notre ordre juridique.
À SAVOIR : Au cours de l’année universitaire 2024-2025, Marc Aurélien TEDGA a rédigé un mémoire de recherche en droit public à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay. Intitulé « Pourquoi les relations juridiques et administratives sont-elles parfois complexes entre le préfet de Police et la maire de Paris en matière de police administrative ? », ce mémoire s’est attaché à analyser les enjeux institutionnels, juridiques et politiques d’une répartition atypique des compétences en matière de police à Paris. Lors de sa soutenance de fin d’études, Marc Aurélien TEDGA avait exposé devant le jury les raisons pour lesquelles, selon lui, le Conseil d’État aurait dû transmettre une QPC portant sur l’article L. 2512-14 du CGCT au Conseil constitutionnel. Faute de temps, il n’avait pas pu développer l’ensemble de sa réflexion ni présenter pleinement sa philosophie. C’est donc avec enthousiasme qu’il partage aujourd’hui avec nos lecteurs, les fondements de son raisonnement juridique. Son travail sérieux et rigoureux, tant sur le fond que sur la forme, a été salué par le jury, qui lui a attribué la note remarquable de « 17/20. FÉLICITATIONS ! ».
Marc Aurélien TEDGA (âgé de 23 ans)
Titulaire d’un BTS Systèmes numériques informatiques et réseaux (Académie de Versailles).
Titulaire d’une Licence 3 en Administration publique, parcours État à l’IPAG de l’Université de Poitiers (Centre universitaire de Paris-Nanterre).
Titulaire d’une Licence 3 Professionnelle en Droit public, parcours Administrations des collectivités territoriales à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay (vice-major de promotion 15/20).
Est étudiant en Master 1 en Administration publique, parcours Gouvernance et Gestions publiques à l’IPAG de l’Université Paris-Nanterre.
Article juridique publié sous le contrôle du Professeur Paul TEDGA
Docteur en droit public de l’Université Paris IX-Dauphine (1988)
Auteur de sept ouvrages
Fondateur de la revue Afrique Éducation en France (1993)
Domaines juridiques : droit administratif ; droit constitutionnel et des libertés fondamentales ; droit des collectivités territoriales ; droit du domaine public et droit routier.
IMPORTANT : Sur le plan juridique le plagiat est une atteinte au droit d’auteur. Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Par conséquent, cela implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de cet article juridique, au cas contraire, la personne utilisatrice de ce document s’expose à des poursuites judiciaires.
BIBLIOGRAPHIE
I – Ouvrages spécialisés
- Environnement magazine, Absence de caractère sérieux d’une QPC portant sur les compétences du préfet de Police de Paris en matière de police de la circulation, publié le 1er mars 2014 (https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2014/03/01/24197/absence-caractere-serieux-une-qpc-portant-sur-les-competences-prefet-police-paris-matiere-police circulation)
- Professeur Olivier RENAUDIE, La préfecture de Police, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 2008, p. 258 (https://www.lgdj.fr/la-prefecture-de-police-9782275033525.html)
- M. René Sève, « L’ordre public à Paris » in Archives de philosophie du droit, Tome 58, Dalloz, 2015, p. 59-69 (https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247152629-archives-de-philosophie-du-droit-l-ordre-public-tome-58-rene-seve)
- M. Yves POZZO di BORGO, P. CHARON et P. DOMINATI, proposition de loi tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police, Sénat, publié le 1er avril 2015, (https://www.senat.fr/leg/ppl14- 391.pdf)
II – Textes juridiques et jurisprudences administratives
- Conseil d’État n° 04749 du 18 avril 1902, publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance.
- Conseil d’État n° 88032 du 10 mai 1974, publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance.
- Conseil d’État n° 370154 du 10 octobre 2013, publié au recueil Lebon, Dalloz, Légifrance.
- Décision constitutionnelle n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 / Nationalisation (non-conformité totale) : Rec. Cons. const. 18 ; RJC I-104 ; JO 17 janv., p.299 ; GDCC, 16e éd., n° 14 ; D. 1981. 361, obs. Hamon ; ibid. 1983. 169, note Hamon ; AJDA 1982. 209, note Rivero ; JCP 1983. 19788, note Franck et Nguyen Quoc Dinh ; JDI 1982. 275, note Goldman ; RGDIP 1982. 349, note Bischoff ; Gaz. Pal. 1982. I. 448, note De Villiers ; GADLF, n° 39.
- Décision constitutionnelle n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 / Bioéthique (conformité) : Rec. Cons. const. 100 ; RJC I-592 ; JO 29 juill., p. 11024 ; GDCC, 16e éd., n° 24 ; RFDA 1994. 1019, note Mathieu ; JCP 1994. 3788, chron. Byk ; RSC 1994. 477, note Delmas-Marty ; RD publ. 1994. 1647, note Luchaire ; RFDC 1994. 799, note Favoreu ; D. 1995. 205, chron. Edelman ; ibid. 299, obs. Favoreu et Renoux ; ibid. 237, chron. Mathieu ; LPA 14 déc. 1994, p. 34, note Duprat ; ibid. 26 avr. 1995, p. 6, note Mathieu ; AFDA 1995. 849, chron. Lachaume ; RSC 1996. 13, note Guidicelli-Delage ; GADLF, n° 45.
- Décision constitutionnelle n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 / Loi relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) (non-conformité partielle avec effet différé) : JO 26 juin 2008, p. 10228 ; GDCC, 16e éd., n° 37 ; D. 2009. 1852, obs. Bernaud et Gay ; ibid. 2448, obs. Trébulle ; AJDA 2008. 1614, note Dord ; Constitutions 2010. 56, note Levade ; ibid. 139, obs. Aguila ; ibid. 307, obs. Aguila ; RFDA 2008. 1233, chron. Roblot-Troiziers et Rambaud ; JCP 2008. II. 10138, note Levade ; Cah. Cons. const. n° 25. 94 ; RFDC 2009. 189, note Capitani ; RD publ. 2009. 1181, note Brosset.
- Décision constitutionnelle n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014 / Plantations en limites de propriétés privés. Sté Casuca : JO 10 mai, p. 7873 ; Rec. Cons. const. 272 ; D. 2014. 1039 ; AJDI 2014. 541, obs. de Gaudemont ; D. actu. 21 mai 2014, note Cayol ; JCP Adm. 2014, n° 20, p. 10 ; JCP 2014, n° 26, p. 1293, note Mekki ; JCP 2015, n° 36, p. 1543, chron. Mathieu ; LPA 2014, n° 250, p. 7, note Reboul-Maupin ; ibid 2015, n° 223, p. 7, chron. Verpeaux ; ibid., n° 227, p. 4, chron. Baghestani ; Dr. Adm. 2015, n° 5, p. 18, chron. De Montalivet : C. civ., art. 671 et 972 ; (absence de méconnaissance de la Charte de l’environnement) ; (absence de méconnaissance du droit de propriété) ; conformité ; décision de renvoi : Civ. 3e, QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608 P : D. actu. 17 mars 2014, obs. Le Rudulier.
- Décision constitutionnelle n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 / Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (non-conformité partielle – réserve) : JO 11 sept. 2018, Cons. const. 19, 21 ; text. n° 2.
- Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
- Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des Institutions de la Ve République.
- Loi ordinaire n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
- Loi ordinaire n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
- Loi ordinaire n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.