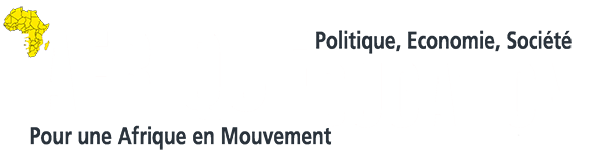X
LES ECHOS DE LA CENSURE (N° 8) D’AFRIQUE EDUCATION EN MAURITANIE
Date
Nous entrons dans le 6e mois de censure du bimensuel Afrique Education en Mauritanie. Président de la République, Maouyia Ould Sid’Ahmed Taya refuse toujours de lever cette interdiction d’un autre âge qui impose aux Mauritaniens de la Mauritanie la lecture du magazine par le net (www.afriqueeducation.com). Le colonel Taya ignore peut-être que chaque « Echo de la censure d’Afrique Education en Mauritanie » est lu sur internet, imprimé, photocopié et distribué sous les gandourah à Nouakchott et dans certaines autres grandes villes du pays. Autrement dit, censure (or not) censure, Afrique Education se lit correctement dans le pays du petit colonel.
D’autre part, des représentants des esclaves soutenus par des organisations comme le FLAM seront présents au prochain Sommet de l’Union africaine à Addis Abeba. Objectif : porter le problème de l’esclavage et du racisme pratiqués en Mauritanie contre les Noirs et les Hartani au niveau des instances de l’Union africaine.
Rappelons que le bimensuel Afrique Education est interdit sur l’ensemble du territoire mauritanien depuis début décembre 2003 suite à l’éditorial paru dans le numéro 144 du 16 au 30 novembre, dans lequel Maouyia Ould Sid’Ahmed Taya était traité de « petit raciste » et d’ « esclavagiste ».
LA MORT NE VOULAIT PAS DE MOI (2e partie)
Les tortures étaient pratiquées de différentes façons. Par exemple, on creusait des trous dans le sable, on nous enterrait jusqu’au cou, la tête immobilisée, le visage nu tourné vers le soleil. Si on essayait de fermer les yeux, les gardes nous y jetaient du sable. Ensuite, on nous remettait nos bandeaux. D’autres prisonniers étaient emmenés jusqu’à un puits, qui ne contenait que peu d’eau. Ils étaient attachés par les pieds à fond. Ils suffoquaient, on les ressortait, et on recommençait… Ces tortures n’étaient plus faites pour qu’on parle du complot, tout le monde savait maintenant que le coup d’état, soi disant en préparation, n’avait jamais existé. Les tortures étaient gratuites, elles avaient pour but de nous éliminer, nous les Noirs, les Maures du système savaient que même les rescapés seraient des gens diminués pour toujours. La guerre du Golfe servait de prétexte, la haine expliquait tout. Cela dura vingt et un jours, jusqu’à l’arrivée d’un officier de renseignement de l’état major. Ce matin là, on nous retira nos bandeaux, ainsi que les menottes entravant nos pieds. On ne garda que celles des mains, attachés dans le dos. Les gardes nous firent sortir, cinq par cinq, en dehors de la prison. L’officier n’en avait pas franchi la porte, il se tenait assis derrière la table, et prenait des notes, le capitaine assis à ses côtés. Certains d’entre nous ne pouvaient plus tenir debout. Ceux-là ont été traînés ou même transportés. Lorsque ce fut mon tour de passer devant lui, l’officier se mit debout, s’avança vers moi. J’étais sale, comme les autres et abîmé de partout. Il me souleva la tête, me demanda si je le reconnaissais. J’y voyais très mal, mais j’ai dit oui. Nous nous connaissions depuis des années, il savait ma conduite toujours exemplaire : « pourquoi lui a-t-on fait ça ? », a-t-il demandé en voyant sur moi les traces de tortures. Il a ordonné au chef d’enlever tout de suite le tabac qui restait dans mes yeux, et demande qu’on fasse venir un médecin. Le capitaine a répondu qu’il était d’accord. On m’a mis de côté, et l’officier s’est occupé des autres prisonniers. Je ne l’ai pas revu avant son départ pour Nouakchott. Un médecin est venu, il m’a examiné, m’a fait une ordonnance pour des médicaments. Lorsqu’il est parti, le capitaine a déchiré l’ordonnance et m’a jeté les morceaux de papier au visage…
J’ai déjà dit qu’au début, nous étions environ 70 en prison. A la fin, il n’en restait que 16. Les autres étaient « partis ». Quand un prisonnier ne pouvait plus tenir, il disparaissait. Nous demandions où il se trouvait, on nous répondait : « A l’hôpital ». Mais en vérité, il avait été exécuté en cachette. Nous avons su tout cela seulement à notre sortie. Avant, nous l’ignorions, même si nous avions des doutes. Nous, les survivants, nous nous trouvions aussi en bien mauvais tat. Moi, je n’y voyais plus du tout, les camarades dirigeaient mes moindres gestes. Après la visite de l’officier, les tortures cessèrent pourtant. Une délégation officielle est arrivée de la capitale, le 6 mars 1991 pour nous libérer. D’autres prisonniers l’avaient déjà été dans d’autres camps, dans d’autres prisons. Notre chef, lui, n’avait pas voulu nous rendre notre liberté, il avait écrit à l’état major que nous étions trop visiblement abîmés pour nous relâcher. Donc, la délégation est venue. On nous a rassemblé, certains tenaient sur leurs jambes, d’autres étaient par terre. Le responsable de la délégation s’est adressé à nous, nous a déclaré qu’il parlait au nom du président de la République et du chef du gouvernement, le colonel Maouyia Ould Sid’Ahmed Taya. Il nous adressait ses salutations. Si nous étions emprisonnés, c’est que des soupçons avaient pesé sur nous : « Entre militaires, vous le savez, nous avons l’habitude de punir ceux qui trahissent et complotent. Nos vêtements neufs et vous serez libres. N’oubliez pas que vous êtes des Mauritaniens comme les autres. Ne parlez pas de ce qui vous est arrivé ». Ensuite, le responsable a dit aux gardes de nous donner à manger. Ceux-ci se sont regardé, et l’un d’entre eux a levé la main pour demander la parole. Il a demandé si nous, les militaires torturés, nous allions rester en service dans l’armée comme auparavant ? Le chef a répondu affirmativement. Le garde a repris alors : « S’ils sont maintenant dans l’armée, comme il y en a de plus gradés que nous, nous risquons d’avoir des ennuis avec eux ». Cette remarque a dû paraître justifiée puisque nos tortionnaires ont été affectés dans une garnison au nord-est du pays, très loin de T… et de R…
Le lendemain, on m’a conduit à l’hôpital de R… j’avais mal aux jambes. Je pouvais à peine marcher. Je n’arrivais plus à me servir de mes mains pour manger. Et je ne parle pas de mes yeux. Même me sachant libre, en théorie, je pensais toujours à la mort. Des gardes nous surveillent pour empêcher les visites. La nouvelle de notre libération s’était répandue, d’autres prisonniers d’autres camps étaient déjà rentrés chez eux grâce à des congés octroyés par l’armée. Beaucoup sont morts à ce moment là peut-être à cause du rétablissement trop brutal d’une alimentation normale. Toujours à l’hôpital, j’ai appris que le président de la République nous avait accordé son « pardon » pour ce complot qui n’avait jamais existé. Il ne s’agissait plus d’excuses comme on nous l’avait annoncé en prison ! Lorsque je fus quelque peu rétabli, on me transféra à l’infirmerie de l’état major à Nouakchott.. Je n’avais toujours pas de contacts avec quiconque, on ne voulait pas qu’on puisse me voir dans mon état. Des parents sont allés se plaindre au ministère de l’Intérieur qui coiffe les unités de la garde. Ils ont demandé si j’étais toujours en prison ou alors libéré ? Le ministre de l’Intérieur a ordonné qu’on me laisse rencontrer ma famille. Ma mère est arrivée de mon village qui se trouve à 400 kilomètres de la capitale. Beaucoup auraient voulu l’accompagner, parents, amis, mais ils avaient peur que les autorités puissent penser qu’ils venaient non seulement pour me voir, mais aussi pour témoigner dans une quelconque enquête qu’on aurait faite sur mon cas. Ma femme et mes enfants n’ont pas quitté la maison, c’est peut-être mieux car ils auraient souffert de me voir transformé comme j’étais, méconnaissable. Ma mère a pleuré lors de notre première rencontre, ensuite, elle m’a réconforté. Elle a commencé à me prodiguer les soins traditionnels de chez nous, avec nos produits, elle me faisait des massages, elle passait des nuits entières à mon chevet… J’ai subi aussi une opération aux yeux, pratiqués par un médecin français, mais il me fallait maintenant d’autres soins, nombre de médicaments coûteux que ma famille ne pouvait payer. Mes parents demandèrent à voir mes supérieurs pour leur parler de ça, mais la demande fut bloquée au niveau du secrétariat de l’état major. Après des mois d’attente, j’ai décidé de rencontrer moi-même le chef d’état-major. Un matin, je suis allé l’attendre au parking où il garait sa voiture. Je l’abordai lorsqu’il arriva et je lui expliquai le motif de ma demande, une demande d’audience qui traînait depuis quatre mois. Le chef me donna rendez-vous le jour même, à quinze heures. Je fus introduit dans son bureau, il me connaissait depuis longtemps, je lui racontai mon arrestation, les conditions de ma détention. Maintenant, j’étais libéré, mais malade, sans moyens pour me soigner. Je lui montrai les ordonnances du médecin. Je lui dis que je voulais guérir.
Le chef m’a bien regardé, il a réfléchi quelques minutes et appelé son ordonnance. Je reçus l’argent nécessaire à l’achat de mes médicaments et une voiture vint me chercher pou me ramener à l’hôpital. Comme je lui avais parlé de ma famille et dit que je n’avais pu rencontrer que ma mère, le chef donna aussi des ordres pou m’organiser un séjour au village. Une voiture avec un chauffeur fut mise à ma disposition, chargée de cadeaux pour les miens : cent kilos de riz, quarante litres d’huile et une bonne somme d’argent. Je fus heureux de me retrouver chez moi, de retrouver ma famille. J’ai appris qu’après mon arrestation, on avait renvoyé mes enfants de l’école… parents et voisins pleuraient en me voyant, me faisaient fête, me prodiguaient des marques d’amitié. Seulement, j’étais presque aveugle et j’éprouvais sans cesse des malaises, en particulier, chaque fois que je mangeais, je me sentais diminué physiquement, je ne pouvais même plus « approcher » ma femme… Après vingt jours passés au village, je suis allé au poste local de la garde et demandé de retourner à Nouakchott pour revoir le médecin.
A l’état major, j’ai rencontré le chef de la même manière que la précédente. Il m’a aimablement demandé des nouvelles de mon congé, de ma famille, il m’a dit de continuer à me soigner. A ce propos, j’ai répondu que mon médecin voulais que j’aille en France pour qu’on m’y fasse une greffe de la cornée, qui me permettrait d’y voir à nouveau comme avant. La demande de mon médecin est passée de l’état major au ministère de la Santé, puis à la direction du Budget. Là, on s’est exclamé : il n’était pas question d’opération en France, on avait déjà trop de dettes à l’égard de ce pays, et pas d’argent pour les payer. On m’a parlé d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, ou alors du Maroc. Les choses suivaient lentement leur cours, je perdais patience, lorsqu’une cousine me fit rencontrer une sœur de charité française. Sa visite eut lieu une nuit car elle ne voulait pas se compromettre au grand jour en rencontrant des Noirs. La sœur a photocopié mes papiers et les a emmenés en France lors d’un congé. Brusquement, j’ai appris qu’une association acceptait de me prendre en charge, l’ACAT (Association catholique d’aide aux torturés). La nouvelle me rendit mon envie de vivre, j’allais enfin guérir, me retrouver comme avant. Le 29 février 1992, je pris l’avion, on m’avait confié à un médecin, mon grand frère m’attendait à l’aéroport en France.
Quinze mois s’étaient écoulés depuis son arrestation, ses épreuves. O.N. venait en France plein d’espoir pour obtenir réparation du passé, se faire opérer, retourner chez lui, recommencer à vivre. Son espoir ne fut pas exaucé. Durant les six premiers mois, son état général s’améliora pourtant progressivement. On soigna son dos qui avait conservé des séquelles de coups reçus, il subit l’une après l’autre plusieurs opérations à ses yeux, mais il s’agissait seulement d’arranger les paupières abîmées dont les cils frottaient la cornée. L’œil droit voyait très mal, l’œil gauche était mort. Mais contrairement aux prévisions antérieures, il s’avéra finalement qu’une greffe serait inopérante. Il fallut le lui dire.
O.N. se révolta, le spécialiste n’y connaissait rien, on lui avait promis que… Un second médecin confirma le jugement du premier. O.N. en ressentit une immense déception, il eut la sensation d’une tromperie nouvelle, s’ajoutant à celle éprouvée en Mauritanie où 25 ans de conduite exemplaire à l’armée n’avaient pas empêché l’injustice. « Je n’y voyais rien, je ne pouvais retourner à l’armée comme avant… ». Non, la vie ne recommencerait pas, la réalité réapparaissait, triste et sans perspective : la mal-voyance, toutes les autres séquelles des tortures endurées, l’éloignement du pays, la séparation d’avec sa famille, les souvenirs douloureux, les camarades morts… Pour ajouter encore à un état devenu dépressif, O.N. apprit une terrible nouvelle, l’arrestation de son frère cadet, dans son village natal, à la suite du meurtre d’un maure. Ce dernier avait été victime d’un peul du Sénégal, avant de mourir, il avait dénoncé son assassin au commandant de brigade du village. Cela n’empêcha pas l’arrestation du frère de O.N. et de trois autres Noirs du village, ni leur mise à la torture pour avouer un crime qu’ils n’avaient pas commis. Quant au commandant, on l’affecta à un autre poste, 1.000 kilomètres de là : il avait rapporté la vérité au préfet du département donc, contrarié le cours officiel de la justice… « J’avais toujours espéré revenir chez moi, je ne voulais pas me séparer de ma famille, de mes enfants, certains très jeunes ». O.N. ne savait que décider à présent, les nouvelles de Mauritanie n’étaient pas rassurantes, la répression anti-Noirs reprenait de plus belle dans la vallée. S’il repartait, que lui arriverait-il ? Il risquait la prison à nouveau, peut-être même la mort. Sa longue hésitation lui provoqua une autre maladie, le diabète, une hospitalisation urgente. Enfin, il y eut l’affaire du colonel Boïlil, tortionnaire et assassin de trois cents militaires noirs, un des principaux responsables des événements de fin 1990. Pour qu’il se fasse oublier, le gouvernement mauritanien l’avait fait admettre en stage à Paris, à l’école de guerre inter armes. Les autorités françaises l’expulsèrent et le nom de O.N. figurait à Nouakchott sur la liste de ceux qui étaient soupçonnés de l’avoir dénoncé.
« Je n’étais même pas au courant de la présence du colonel en France », dit O.N. Quoi qu’il en soit, sa famille le prévint : « Si tu rentres au pays, ils vont te prendre ». Cette fois, la chose était claire, il ne pouvait plus repartir. Non sans une profonde amertume. O.N. demanda l’asile politique qui lui fut aussitôt accordé, il entreprit des démarches nécessaires à la venue en France de sa femme et de ses enfants. Ce qui n’était pas simple : par exemple, lors de son arrestation à T., les militaires avaient recherché dans ses affaires des papiers éventuellement compromettants et ils en avaient profité pour brûle ses papiers personnels dont les originaux des actes de naissance de ses enfants. Remis de son diabète, O.N. réagit, chercha du travail et en trouva dans les cuisines d’un restaurant… pas pour longtemps, il n’y voyait pas assez clair. « Je mélangeais les différentes sortes de fourchettes », raconte-t-il. Il dut abandonner, la mort dans l’âme, sans plus vouloir rechercher d’autres activités.
Aujourd’hui, il a terminé ses démarches administratives, son énergie est retombée malgré les soins réguliers de son médecin. Il vit en province, chez son frère, au bord de la mer. Il attend les siens en regardant longuement l’image trouble de ses enfants sur les photographies qui viennent du pays, où son frère cadet est toujours en prison, depuis six ans, sans jugement, accusé de meurtre sans preuve sinon « Noir ». Il n’a rien d’autre à faire au long des jours qu’à ressasser son passé. La nuit, malgré les médicaments, les vieux cauchemars reviennent : il se trouve dans un cimetière, des gardes maures creusent sa tombe dans le sable, comme au champ de tir de R… ou dans la prison de T… il lui semble qu’il va mourir, au dernier moment, il s’éveille…
Son médecin écrit dans un rapport : « Bien que particulièrement lourd, le camp de Monsieur O.N. n’en est pas moins exemplaire des dégâts physiques et psychiques que peuvent engendrer la torture et la répression… »
Témoignage recueilli par Yvette Adam