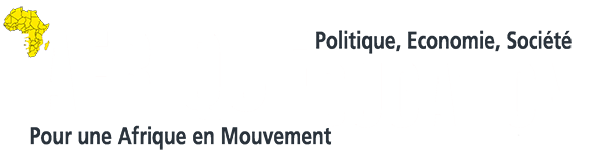X
FRANCE : Qui a tué le parti socialiste français (Hollande, Valls, Cambadélis, Macron…) ?
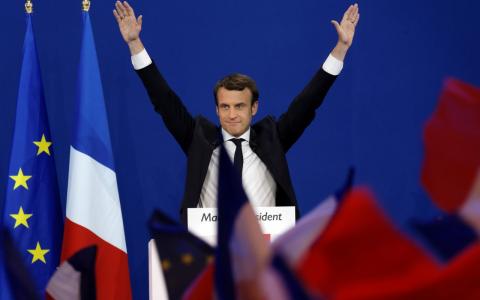
Date
Il était tout-puissant en 2012, il n’en reste presque plus rien cinq ans plus tard. Après une élection présidentielle calamiteuse (à laquelle son champion, François Hollande, ne s’est pas présentée pour cause de très mauvais bilan), les élections législatives parachèvent l’extinction du Parti socialiste en tant que grand parti de gouvernement. Sur 414 candidats investis par le PS, seuls 65 ont réussi à se qualifier pour le second tour, dimanche, 11 juin. La semaine prochaine, ils ne pourraient être que 20 à 30 à siéger à l’Assemblée nationale, selon notre projection réalisée par l’institut Ipsos. Dix fois moins qu’après l’élection de François Hollande, en 2012.
« Les résultats des socialistes doivent être regardés avec lucidité et il faudra en tirer toutes les conclusions au lendemain du second tour, pour rebâtir la gauche de gouvernement sur des bases saines et rénovées », a déclaré, dans un communiqué, l’ancien premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui est de plus en plus cité pour remplacer l’actuel premier secrétaire, Jean Christophe Cambadélis, défait dans sa circonscription, à Paris, dès le premier tour, après y avoir été député pendant 20 ans.
Nombre d’adhérents en chute libre, défaites lors de toutes les élections locales intermédiaires, débats d’idées au point mort, divisions internes… Le Parti socialiste sort exsangue de ses cinq années aux affaires. Si la structure existe encore, le PS semble bel et bien devenu cet « astre mort » décrit il y a quelques années tant par Jean-Luc Mélenchon que par Dominique Strauss-Kahn. Président de la République, chef du parti, députés… Qui est responsable de cette situation ? Analyse sur les torts des principaux accusés.
François Hollande et ses promesses non tenues
L’histoire retiendra peut-être que François Hollande fut le dernier président socialiste avant liquidation. Ne serait-ce que par les fonctions qui ont été les siennes pendant cinq ans, l’ancien chef de l’Etat porte une lourde responsabilité dans l’état de délabrement de son parti. Elu sur la promesse de s’attaquer au monde de la finance et l’ambition de renégocier le traité budgétaire européen pour mettre fin à l’austérité, François Hollande a très vite déçu, y compris au sein de son propre camp.
« Le chef de l’Etat a déboussolé ses électeurs, commentait, en avril, le chercheur en science politique Renaud Payre. Celui qui, en 2012, s’adressait à l’ensemble de la gauche n’a pas fait comme l’un de ses modèles en politique, Lionel Jospin : il n’a pas ouvert le pouvoir à l’ensemble des forces de gauche. » Erreur stratégique, mais aussi, faute politique : sa politique de l’offre, visant à baisser les charges des entreprises, a été décidée en 2014 alors qu’elle ne figurait pas dans son programme. Un revirement qui a eu le don de braquer nombre de socialistes. Et à le rapprocher beaucoup plus de la chancelière Angela Merkel.
Le PS a payé cash son incapacité à clarifier sa ligne politique avant d’accéder au pouvoir. Là encore, François Hollande, qui fut premier secrétaire du PS de 1997 à 2008, a sa part de responsabilité. Alors champion de la « synthèse », il avait réussi à préserver l’unité du parti, mais, en éludant les débats qui auraient dû permettre sa mutation. Ni la défaite de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle en 2002, ni le référendum sur la Constitution européenne en 2005 n’ont servi d’électrochoc.
Valls et sa théorie des gauches irréconciliables
« La gauche gagne quand elle est unie et crédible. Elle perd quand elle est divisée et en dehors des réalités », tweetait Manuel Valls en janvier, pendant la primaire de la gauche. Le postulat semble couler de source, mais, pas dans la bouche de l’ancien Premier ministre, qui n’a eu de cesse, avant et durant le quinquennat, de transgresser, cliver et bousculer son camp.
Des 35 heures, qu’il voulait « déverrouiller » en 2011, à ses positions très tranchées sur le voile, décrit comme un « asservissement de la femme » en 2017, en passant par les Roms, qui « ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie » en 2013, ou à son fameux « J’aime l’entreprise » devant le Medef en 2014, Manuel Valls n’a cessé de crisper la gauche.
Sa sortie sur les actes terroristes qu’il ne faudrait selon lui pas chercher à comprendre « car expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » a encore creusé le fossé entre deux gauches de moins en moins en phase. En 2016, il avait lui-même théorisé cette désunion : « A gauche, il faut qu’on se dépasse. Le problème n’est pas d’organiser une primaire qui irait de Mélenchon à Macron. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l’assumer », avait-il déclaré devant des militants socialistes de l’Essonne.
Loi Travail, utilisation du 49-3 pour outrepasser l’opposition des députés, défense de la déchéance de nationalité… Durant son bail à Matignon, Manuel Valls n’a rien fait qui puisse préserver l’unité du PS. Peut-être avait-il oublié que, tout Premier ministre qu’il était, ses idées étaient loin d’être majoritaires à gauche : en témoigne son score de 5,63% à la primaire socialiste en 2011.
Les frondeurs et leur opposition mortifère
Dès le début du quinquennat, le ver était dans le fruit. Une trentaine de députés PS, fraîchement, élus ou réélus, refusent de voter le traité budgétaire européen, arguant que le texte soumis à leur approbation n’a pas été renégocié, comme l’avait pourtant promis François Hollande durant la campagne.
La suite ressemble à une longue et usante guerre de tranchées avec l’exécutif. Ce groupe de parlementaires, qui a décidé de faire fi de la discipline de vote, exprime son mécontentement sur chaque texte de loi qu’il estime trop libéral ou insuffisamment à gauche. Dans les médias, leurs chefs de file se répandent à longueur d’interviews pour dire tout le mal qu’ils pensent de la politique de François Hollande.
L’image est dévastatrice pour le PS, qui apparaît aux yeux du grand public comme un parti incapable de gouverner sans se perdre dans des débats internes. Le psychodrame atteint son paroxysme en mai 2016, lorsque les frondeurs tentent de provoquer une motion de censure, en réponse à l’utilisation par le gouvernement du 49-3 sur la loi Travail. Même s’ils ne parviennent à recueillir que 56 signatures parmi les députés de gauche, au lieu des 58 requises, le signal est très fort : pour la première fois, dans l’histoire récente de la Ve République, un groupe de députés cherche à faire tomber un gouvernement issu du même parti. « Les ‘frondeurs’ confirment que le pouvoir socialiste est leur principal adversaire », écrit, à l’époque, le politologue, Gérard Grunberg dans Le Monde.
Dans ce contexte, la primaire de la gauche organisée, début janvier 2017, ne pouvait que déboucher sur un échec. La large victoire de Benoît Hamon sur Manuel Valls a, certes, fait triompher une ligne sur l’autre, mais, n’a, en aucun cas, permis le rassemblement des socialistes. Quand le candidat du PS faisait de l’œil à Jean-Luc Mélenchon pour le convaincre (sans succès) de se désister à son profit, des hordes de hollando-vallsistes, eux, se sont mis à lorgner vers Emmanuel Macron.
Macron et son travail de sape efficace
En créant son propre mouvement, en avril 2016, en démissionnant du ministère de l’Economie, fin août, puis, en se déclarant candidat à l’Elysée le 16 novembre, Emmanuel Macron (notre photo) a lancé un défi à François Hollande. Quelques semaines, plus tard, l’audace devient exploit : pour la première fois, sous la Ve République, un président sortant renonce à se représenter.
Certes, Emmanuel Macron a profité d’un incroyable alignement des planètes : les défaites d’Alain Juppé et de Manuel Valls lors des primaires, qui lui ont ouvert un immense espace au centre, l’affaire Fillon… Mais, il a, aussi, construit une grande partie de son ascension sur le dos du parti présidentiel. Son mouvement, En marche !, a drainé des centaines de sympathisants et des dizaines d’élus socialistes, conquis par son dynamisme et sa promesse de renouveau.
Ringardisé, puis, battu à plates coutures dans les urnes à la présidentielle, le Parti socialiste aurait pu espérer limiter la casse aux élections législatives en comptant sur l’implantation de ses candidats. Et pourquoi pas espérer la constitution d’un groupe parlementaire qui aurait servi de force d’appoint à une majorité relative de La République en marche à l’Assemblée nationale.
C’était compter sans l’intransigeance d’Emmanuel Macron, dont le parti a présenté, à quelques exceptions près, un candidat face à chaque prétendant PS. Et refusé à ses candidats la double appartenance PS-La République en marche. Une stratégie qui devrait se traduire, dimanche prochain, par la plus lourde défaite socialiste depuis 1958 en termes de sièges obtenus.
Mélenchon et son siphonnage méthodique
« Ce n’est pas moi qui ai tué le PS, qui l’ai détruit, ce sont les électeurs qui en ont eu assez qu’on se moque d’eux et qu’on leur mente, voilà pourquoi ils l’ont maltraité dans les urnes », s’est défendu Jean-Luc Mélenchon, le 6 juin, sur TF1. Et pourtant, le leader de La France insoumise a, méthodiquement, siphonné l’électorat socialiste – en tout cas celui qui n’a pas cédé aux sirènes d’Emmanuel Macron.
En retard dans les sondages avant le mois de mars, Jean-Luc Mélenchon a réussi à inverser le rapport de force face à Benoît Hamon. Grâce à des débats télévisés réussis, une forte présence sur les réseaux sociaux et un talent oratoire indéniable, il a fait du socialiste un candidat de moins en moins perçu comme un vainqueur potentiel. La mécanique du vote utile a fait le reste…
En se lançant dans la bataille des législatives à Marseille, dans une circonscription très marquée à gauche, plutôt que dans une circonscription où le FN serait en mesure de l’emporter, Jean-Luc Mélenchon a montré qu’il ne comptait pas s’arrêter là. « Je ne veux pas affaiblir le PS, je veux le remplacer », a-t-il expliqué début mai. Avec 10,9% au premier tour pour les candidats de la France insoumise, contre 10% pour ceux du PS, il n’a qu’à moitié rempli son objectif.
Jean-Christophe Cambadélis et Harlem Désir, et leur manque de leadership à la tête du PS
En marge des déboires connus par l’exécutif pendant cinq ans, le Parti socialiste lui-même n’a jamais semblé aussi peu influent sur la conduite du pays. Peu impliqué dans la définition de la ligne gouvernementale, le mouvement a abandonné les confrontations d’idées et les débats idéologiques. Harlem Désir, premier secrétaire de 2012 à 2014, et Jean-Christophe Cambadélis, qui lui a succédé, ont été, vivement, critiqués en interne pour leur manque de charisme.
L’un comme l’autre inaudibles, ils ont incarné l’incapacité du PS à redevenir un espace militant attractif. Alors qu’il comptait 173 000 adhérents en 2012, à l’arrivée de François Hollande au pouvoir, le parti a vu ses effectifs fondre (112 000 revendiqués au printemps 2016). Les congrès de Toulouse, en 2012, et de Poitiers, en 2015, se sont déroulés dans une indifférence quasi-générale. Quant à la traditionnelle université d’été du PS, espace de rencontres et de débats qui se tenait, chaque année, depuis 1993, elle a été, purement et simplement, supprimée. Ultime revers pour Jean-Christophe Cambadélis : il a été balayé, dès le premier tour des législatives, quatrième dans sa circonscription parisienne dont il était député depuis 1997…
Dans son livre La Troisième Gauche, paru en 2012, Jean-Christophe Cambadélis ambitionnait que le socialisme « soit à nouveau une doctrine vivante, capable de transformer le monde et pas seulement de le gérer ». En mai, une semaine avant l’élection d’Emmanuel Macron, le patron des socialistes livrait ce verdict sur l’état de son propre parti : « Après le 18 juin, on fera le bilan de tout ça, mais il est clair qu’il faudra une reconstruction voire une refondation du Parti socialiste. » Car « le parti d’Epinay est mort, et bien mort », ajoutait-il.
Avec franceinfo